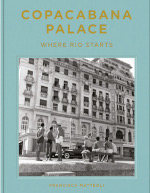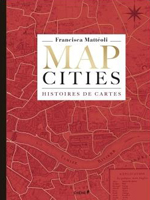Quand j’ai écris mon premier livre, il n’y avait ni internet, ni Google, ni aucune des facilités qu’il y a aujourd’hui pour entrer en contact avec le monde. Tout se faisait par téléphone fixe ou fax. Les 30 destinations que compte ce premier livre (et que j’ai toutes visitées), je les ai trouvées principalement en allant dans le bibliothèques et en discutant avec des amis. Je commençais mes journées au Centre Pompidou. Ensuite, je téléphonais et j’envoyais des fax aux quatre coins de la planète. C’était un vrai labeur, répétitif, solitaire, qui pour faire quelque chose de bien demandait une persévérance de tous les diables. Quand j’y repense, cela me parait assez fou. Je devrais tenir compte des décalages horaires (pour téléphoner du moins), ce qui fait que pendant un bon bout de temps, j’ai été quasiment suspendue au bout du fil 24 h sur 24, de Rio à Tokyo. Il me fallait expliquer mil fois mon projet à la personne, ou aux personnes, au bout de la ligne car pas moyen d’envoyer un simple lien sur lequel cliquer. Quand les réponses arrivaient enfin, elles me réveillaient au milieu de la nuit, mes interlocuteurs faisant allégrement l’impasse, eux, sur le décalage horaire. Je me rappelle mon euphorie, en découvrant dans ma boite aux lettre des paquets en provenance de Hong Kong ou de Patagonie, remplis de documents et de photos qui allaient me permettre d’écrire une belle histoire. Ma déception, quand après des mois de tractations, les dits paquets arrivaient avec seulement quelques feuilles de papiers inutilisables.
Internet a tout balayé. Les moments d’attente atroces à remuer ciel et terre pour obtenir un document en songeant à la deadline. Les explications interminables dans toutes les langues possibles. Les piles de fax que j’emportais avec moi, à toutes fins utiles. Et aussi, l’atmosphère d’inconnu total que comportaient alors les voyages.
Je suis pourtant restée old fashion. J’écris mes premières impressions d’abord sur un carnet. Pendant mes voyages, je prends des notes, des photos, je fais des collages, des dessins tout cela constitue ma base de données. Ensuite, j’élague. C’est souvent douloureux, car j’ai horreur de jeter. J’ai le sentiment d’abandonner le meilleur. Mes histoires demandent une construction très précise. Comme je n’ai pas une place infinie et qu’il y a des choses qui me semblent importantes, je morcelle pour trouver le meilleur équilibre. Une dose de composante personnelle. Une dose de références à des artistes que j’aime (c’est le propre de la série Hotel Stories). Une dose de descriptions de lieux. Je vois ça comme un film. L’entrée en scène des personnages, le décor, le point de vue du réalisateur. Je ne me compare pas à John Ford, loin de là, mais j’ai beaucoup appris en lisant des livres sur les techniques des westerns qui ont fait découvrir l’Amérique aux Américains en montrant des personnages constamment en déplacement. J’essais de garder cette idée de mouvement, cette notion d’action, de faire en sorte qu’il se passe quelque chose. Pas seulement de parler de voyages ou de lieux, mais si je peux, de raconter des histoires.